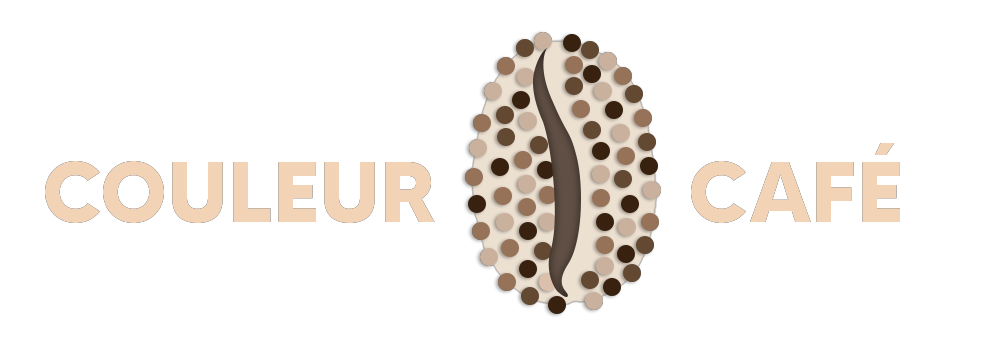SAM MANGWANA, PORTRAIT D’UN ARTISTE PANAFRICAIN
Par Samuel Nja Kwa / Photos : F. Blanquin
Né à Kinshasa de Parents angolais, le chanteur Sam Mangwana est le baobab de la musique africaine. Il sort à l’international Lubamba, un opus publié en 2016 en Angola. Il s’adresse à la jeunesse africaine, revient sur sa vie, ses rencontres, sa musique.
Votre album Lubamba est sorti en 2016 en Angola, il vient de sortir en France, Pourquoi ce deuxième lancement ?
J’avais envie de le diffuser sur le plan international, Paris étant la plaque tournante des cultures, il était nécessaire de le faire dans cette capitale.
Que signifie Lubamba ?
C’est une sorte de liane qui sert à la construction des maisons, à la confections d’objets en Afrique. Elle est utile à la vie courante. J’ai donné ce nom à mon album pour essayer de conscientiser la nouvelle génération qui connait peu sa culture. Je veux lui dire que Lubamba fait partie de nos traditions et de notre manière de voir les choses. J’exhorte les masses populaires à ne pas s’installer uniquement dans les villes, nous avons des campagnes où nous pouvons nous employer à l’agriculture par exemple.
Peut-on comprendre, en écoutant votre musique, qu’il faut défendre nos traditions car avec l’introductions des machines dans la musique, on a tendance à oublier d’où on vient.
La jeunesse est abandonnée à elle-même, elle copie la musique qui rapporte de l’argent, comme le rap, toutes ces musiques urbaines qui font de l’audience. Je ne pouvais pas imaginer il y a 30 ans que les jeunes africains fassent du rap pour se faire entendre. Je trouve ça malheureux. Je sors d’un moule d’une musique née dans les années 30-40 et je ne changerai pas parce qu’une musique nouvelle rapporte de l’argent. Je suis ce musicien qui n’a pas changé. Il y a une certaine richesse, une manière d’aborder les choses avec une certaine pudeur.
Dans cet album on retrouve Manu Dibango…
Oui il m’avait toujours demandé à jouer sur une de mes œuvres. Alors je lui ai réservé Juventude actual. Il y a mis sa touche. J’y parle de la jeunesse actuelle qui n’est pas élevée dans nos traditions et qui tend à une certaine modernité qui s’éloigne de sa culture. Je pense que la jeunesse africaine est en train de passer à côté de son histoire. Il faut puiser dans nos propres cultures. Elles sont inépuisables.
Votre album est panafricain. On y entend de la Morna, de la rumba, de la salsa, du soucouss, des rythmes d’Afrique de l’Ouest…
J’ai grandi avec ces musiques, raison pour laquelle je n’ai jamais voulu qu’on me colle une étiquette en ce qui concerne mon Afrique. Je suis un panafricain. J’ai été élévé dans cette prise de conscience des années 60, pendant la décolonisation.
Que signifie être panafricain en 2021 ?
L’Afrique est corrompue, elle s’est éloignée de la voie qu’elle devait suivre à la fin des années 60. Lorsqu’on me parle d’aide humanitaire, d’aide à l’Afrique, lorsqu’on voit comment nos dirigeants bradent nos richesses, notre jeunesse qui meurt dans la méditerranée, cela signifie que l’Afrique a quelque part loupé son décollage. L’Agronome René Dumont a écrit en 1962 un livre intitulé l’Afrique est mal partie, il a reçu beaucoup de critiques, mais aujourd’hui je ne peux que constater cette triste réalité. Nous ne sommes nulle part et je trouve ça dommage.
Vous chantez en Kikongo, en portugais, en lingala, en swahili, en français c’est aussi ça le panafricanisme…
Il faut valoriser nos langues. Il y a des œuvres qui perdent de leur force lorsqu’elles sont traduites dans une autre langue. Je me souviens de ma chanson Ya Mbemba, chantée en kikongo, un dialecte de la République Démocratique du Congo. Elle a toujours été prisée par les Occidentaux, qui ne la comprennent pas mais la ressentent en l’écoutant. C’est la magie de nos langues.
Dans votre album, il y a une reprise, Félicité, de Joseph Kabasélé de l’African Jazz
Il s’agit d’une chanson sortie en 1954 ou 56, lorsque j’avais 9 ou 10 ans. Ce sont des mélodies qui me sont restées dans la tête, elles n’ont pas pris une seule ride. Elles font voyager, indiquent le chemin à prendre. On peut les moderniser, et les resservir. J’aime les reprendre parce qu’elles ne se perdent jamais.
On vous considère aujourd’hui comme un monument de la musique africaine. Quel effet cela vous fait ?
Je participe en tant qu’artiste à l’écriture de cette culture africaine et j’ai toujours apprécié le savoir des autres. Je ne compte sur personne, je ne suis pas matérialiste, je ne m’accroche pas à ce monde. Il y a la naissance, la vie et la mort, j’y crois, le jour où il faudra quitter cette terre, je m’en irais tout simplement. J’ai eu la chance de côtoyer de grands noms de la musique africaine, j’en suis fier et si un jour je devais moi aussi marquer mon temps, j’en serais heureux.