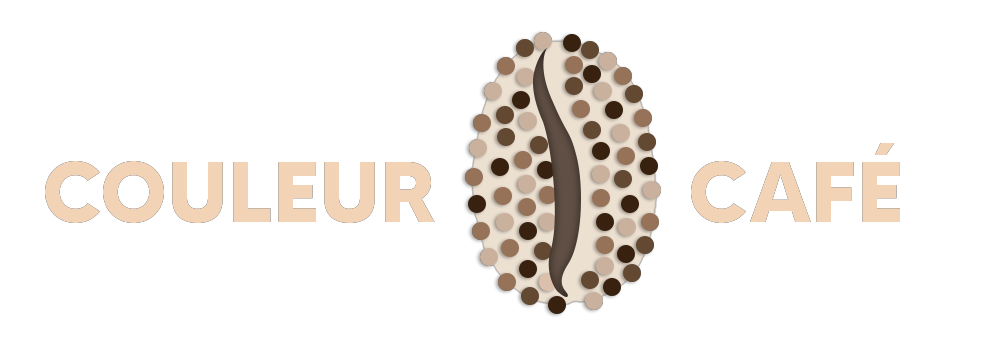L’INCROYABLE DESTIN DE JAMES BKS
Musicien autodidacte, auteur, compositeur, James BKS est l’attraction musicale de l’année. Il est de tous les festivals. Né en France de parents camerounais, c’est aux États-Unis qu’il se révèle et collabore avec les grands noms du milieu hip hop : Ja Rule, Talib Kweli, Snoop Dogg. De retour en France, il remet le compteur à zéro et créé avec sa compagne son propre label, Grown Kid. Nouvelles rencontres, révélations, c’est le début d’une nouvelle aventure. Il se dévoile.
Qu’as- tu appris, musicalement parlant, de ton père biologique Manu Dibango ?
Qu’il ne faut jamais se mettre de limite, ne pas juger, être curieux et toujours se renouveler. A travers lui, j’ai découvert une partie de moi, musicalement parlant, qui a changé le cours de mon histoire. Il m’a donné envie, à un moment clé de ma carrière, de prendre confiance et d’explorer des choses nouvelles.
Quel est ton parcours musical ?
Je viens du hip hop, j’ai fait mes premières armes aux États-Unis où j’ai étudié. C’est là où j’ai pris la musique au sérieux. J’ai toujours été quelqu’un de passionné, je ne voyais pas la musique comme une finalité, pour moi il y avait le sport et la musique. C’est dans cette culture hip hop que j’ai été bercé étant plus jeune, d’abord en France, puis aux États-Unis où j’ai pu vivre ce rêve américain avec mon beau-père, ma mère, mes deux petites sœurs. C’était en 2002. La musique est vraiment venue sur le tard, à partir du moment où je l’ai prise au sérieux je ne l’ai plus quittée. J’ai fait mes premières armes tard, mais les choses se sont passées relativement vite.
J’ai commencé à faire un stage d’audio et d’enregistrement à Atlanta, dans le studio d’Akon. Auparavant, je commençais à faire des enregistrements à Washington pour des artistes locaux jusqu’à ce qu’une mix tape soit née de toutes ces collaborations et qu’elle arrive aux oreilles d’Akon. C’est ainsi que je décroche ce premier stage qui me permet de côtoyer d’autres auteurs dans son label
Ensuite tu as connu une ascension fulgurante
Oui j’ai fait des collaboration avec Puff Daddy, Ja Rule, Snoop Dogg, pas mal d’artistes connus aux-États-Unis et en France, comme Booba, Soprano ou Youssoupha, les Sages Poètes de la rue, Lino. Je faisais pas mal d’aller-retours à cette époque, j’étais vraiment implanté dans le hip hop, c’était une passion, mais je sentais que je voulais faire autre chose.
J’ai grandi dans une maison où on écoutait de la musique africaine, de la musique classique, des variétés françaises, des musiques pop internationales comme Michael Jackson ou Prince. J’ai eu cette envie d’explorer autre chose. Lorsque j’ai commencé à placer mes premiers titres chez des artistes de grande renommée, j’étais catalogué comme « beat maker ».
Te considères-tu comme un beat maker, un claviériste ou un auteur compositeur ?
Je me suis toujours considéré comme un auteur compositeur. J’ai longtemps eu du mal avec l’appellation « Musicien ». Parce qu’à l’époque, je ne me produisais pas. J’ai commencé à composer mes premiers titres au piano, je suis autodidacte, je faisais mes gammes, j’ai toujours été entouré de musiciens et j’ai eu du mal à dire que j’en étais. Plus tard, lorsque j’ai rencontré Manu Dibango, il m’a dit : « en fait tu joues, tu es musicien ! ».
Tu rencontres Manu Dibango en quelle année ?
En 2012.
Lorsque tu es entré dans le milieu artistique et musical, étais-tu conscient de ce lien qu’il y avait entre vous ?
J’ai fait mes premières armes autour de 2006. J’étais encore à Washington. Lorsque ma mère s’est rendue compte que la musique prenait de plus en plus de place dans ma vie, elle m’a révélé l’identité de mon père biologique. Je savais que j’avais un père biologique ; mais ma vie, bien que complexe vu de l’extérieur, était quand même une belle vie dans le sens où j’ai toujours vécu dans l’amour. J’ai eu la chance d’avoir un père de cœur, qui m’a vu naître, m’a éduqué, m’a élevé et qui est encore là aujourd’hui, ma mère et mes deux petites sœurs. J’étais dans un cocon où je me sentais privilégié. J’ai vécu dans une famille très modeste, et j’ai toujours senti cet amour autour de moi. Ce qui fait que lorsque ma mère m’a révélé l’identité de mon père biologique, je l’ai immédiatement rejeté. J’ai eu du mal avec le fait de savoir de qui il s’agissait, de savoir qu’effectivement cette personne est connue. J’ai été bercé par ses chansons étant plus jeune, j’avais l’image d’une star africaine assez éloignée de mon univers. A partir du moment où ma mère m’a révélé qui était mon père, je me suis dit que si je dois réussir dans cette industrie, ce serait par moi-même. Il y avait une sorte de revanche personnelle que je voulais prendre par rapport à la vie. Cette envie de protéger mon cercle.
Entre 2006 et 2012, j’entendais souvent parler de lui. J’avais des amis qui parlaient de lui sans connaitre le lien que j’avais avec lui. C’était un secret de famille, très peu de gens le savaient autour de moi. J’entendais souvent son nom, jusqu’au moment où je suis rentré en France, en 2012. J’ai décidé de rentrer et de recommencer tout à zéro. J’ai cassé mon contrat avec Universal aux États-Unis, j’ai monté ma propre structure avec ma compagne et j’ai appris le business sur le terrain. Il a fallu que je me renouvelle que je réapprenne ce qu’est l’industrie du disque. Ça a été un chemin de croix, parce que les gens ne comprenaient pas mes choix. J’étais aux États-Unis, j’ai travaillé avec untel ou untel, pourquoi revenir en France ? Dans le milieu de la musique la « Mecque » c’est les States. Mais je voulais reculer pour mieux avancer.
Durant cette période, il a fallu que je refasse mon Curriculum Vitae, que je me fasse un réseau. Dans ce processus, j’ai été dans des conférences sur l’industrie de la musique, et c’est via le Midem que j’ai commencé à décrocher des rendez-vous, dont un éditeur qui voulait me voir afin de me proposer un projet. Nous nous sommes rencontrés à l’hôtel Zébra à Paris, et c’est là que je suis tombé nez à nez avec Manu Dibango. Ce n’était pas prévu, je me voilais la face. Lorsque je l’ai vu, sa façon de parler, son rire, sa démarche, je me suis vu en lui. Je n’avais jamais rien ressenti de tel auparavant. Des questions fusaient dans ma tête, nous avons discuté pendant 5 minutes ensuite il a enchaîné avec des journalistes. Il faisait la promotion de l’album « Past Present Future ». L’éditeur qui était en retard est finalement arrivé pendant que Manu finissait son interview. Il me le présente et me propose de travailler sur des remix de son artiste. Manu s’approche de moi et me tend la main en me disant : « Bonjour fils ! » sans savoir qui j’étais. Je ne lui ai pas dit qui j’étais. Il s’est passé à peu près six mois, entre le moment où je l’ai rencontré pour la première fois et le moment où on s’est vraiment retrouvé. Le soir où je l’ai rencontré, j’en ai parlé à ma mère qui a fondu en larmes au téléphone. Elle m’a avoué qu’ils ne s’étaient jamais quittés en de mauvais termes mais qu’elle avait choisi de m’élever toute seule. Elle m’avait toujours dit que si je ressentais le besoin d’aller vers lui, elle m’ouvrirait la porte. Mais je ne l’ai jamais voulu. Je lui ai demandé ce qu’il fallait que je fasse, elle m’a répondu « Va vers ton destin ». C’est ce que j’ai fait. Mais j’ai voulu le faire de la meilleure manière possible. Parce que je voulais qu’il comprenne qu’il avait un fils musicien et que ce fils en question s’était fait tout seul. C’était ce qu’il y avait de plus important pour moi à ce moment-là. Mais je ne savais pas que cette rencontre allait vraiment changer le cours de ma vie.
Ton nom de scène Best Kept Secret (BKS) te vient-il de ton histoire ?
Paradoxalement non. Best Kept Secret qui signifie le secret le mieux gardé est un pseudonyme que j’ai trouvé lorsque j’ai commencé à prendre la musique au sérieux. C’est un nom que j’ai trouvé en écoutant un album de Pete Rock intitulé Best Kept Secret. J’aimais bien cette appellation, le côté réservé, je me retrouvais totalement dans cette expression. Aussi du fait que lorsque j’ai quitté la France pour les États-Unis, les gens pensaient que j’allais faire du basket puisque c’était ma passion. Et j’ai commencé à faire de la musique sans que personne ne le sache. Au final, tout cela a pris un autre sens.
Ta musique, aujourd’hui, se rapproche plus de l’Afrique, tu as eu une expérience Américaine, française, très urbaine, comment s’est opérée cette évolution ?
La musique est une sorte de langage. L’Afrique a été, pour moi, un grand point d’interrogation. C’était la partie de l’iceberg la plus cachée de mon histoire. Oui, je suis noir, j’ai mes origines, je suis né en France où j’ai grandi, j’ai passé ensuite 10 années de ma vie aux États-Unis. Il n’y avait que le côté folklorique de l’Afrique dans ma maison bien que ma mère soit Camerounaise, qu’elle ait vécu son histoire, sa manière de nous protéger de ce qu’elle a pu vivre, indirectement nous a décroché de ce continent. C’est en grandissant, en commençant à me cultiver, en lisant des livres, en voyageant et en rencontrant d’autres personnes, que ma curiosité par rapport à mes origines m’a rattrapé. On arrive à un âge où on a des enfants, on a envie d’aller vers ses origines. La musique, pour moi, est une porte d’entrée. Elle me permet d’explorer autre chose. Lorsque j’ai rencontré mon père biologique, il m’a permis de rencontrer ses musiciens, de parler avec eux, de pouvoir le suivre en tournée. C’est à travers lui que j’ai découvert la musique africaine, avec un grand « A », pas que le folklore, toutes ses subtilités, ses rythmes que je ne connaissais pas. J’ai pu connaitre l’histoire de mon père, de l’Afrique. En l’entendant parler, en échangeant avec ses musiciens, notamment Guy Nwogang, son batteur, qui m’a ouvert la porte de sa maison et qui m’a invité à découvrir tous ces rythmes que je ne connaissais pas. J’ai été séduit, je suis tombé amoureux de mes racines grâce à la musique. J’avais envie de me renouveler, et dans ma volonté de trouver une identité musicale, je me suis rendu compte que tout est en moi. J’ai affiné mes recherches et j’ai puisé ce qu’il y avait en moi. Ce langage m’a permis de mélanger ce que je savais déjà faire avec ce que je commençais et continue encore à apprendre aujourd’hui.
En juin dernier, tu as participé au Moca, l’événement créé par Alain Bidjeck, où tu as créé une chanson avec Youssoupha, qui était aussi présent. Si on remonte aux années 60, ton père, Manu Dibango, a travaillé aussi avec l’artiste Congolais Tabu Ley Rochereau, le père de Youssoupha. Il n’y a pas de hasard.
Je connais Youssoupha depuis un bon nombre d’années, nous avons eu l’occasion de travailler ensemble à deux reprises. C’était une très belle rencontre. Nos histoires sont assez spéciales, nous n’en avons jamais parlé ouvertement, mais nous avons toujours été bienveillants l’un envers l’autre. Je me souviens que lorsque son père nous a quitté, je l’ai tout de suite appelé et il en a fait de même lorsque Manu est parti. Nous ne partageons pas forcément ouvertement nos histoires, nous traçons notre route. C’est aussi important pour nous d’être nous-mêmes en tant qu’artiste, d’embrasser notre histoire, et de se développer en tant que lui Youssoupha et moi, James, non pas « fils de… ».
Tu travailles aussi avec Idris Elba, il a son label, 7Wallace, tu as le tien, Grown Kid, comment se passe votre collaboration ?
J’ai monté avec ma compagne un label qui s’appelle Grown Kid. En 2017, Idris a entendu le titre Kwele et a souhaité me rencontrer. Je suis fan de lui depuis bon nombre d’années. Je connais son travail d’acteur, et aussi ce qu’il fait dans la musique. Il a produit dans l’ombre pour un grand nombre d’artistes, il est D J et possède une vraie fibre musicale. Lorsqu’on s’est rencontré, il a tout de suite accroché, on s’est lié d’amitié et nous avons commencé à travailler ensemble. Son exposition dans le milieu, son charisme, son influence, m’ont permis d’avoir une plateforme plus importante lorsque j’ai lancé mon premier titre. Nous sommes restés très proche. Je n’ai jamais signé dans son label, ça a toujours été un partnership.
Dans ta musique, on entend des paroles en duala, en swahili, en anglais, en bulu…
C’est un parcours initiatique. Le swahili a été un moyen détourné pour me reconnecter avec mes racines. C’est une langue est très chantante, j’ai une âme de panafricain et je sais que c’est une des langues les plus parlée en Afrique. C’était une manière de m’adresser au plus grand nombre. J’ai envie d’apprendre les langues d’où je viens. A travers les années, j’ai commencé à écrire en Swahili avec une dominante en anglais, j’écris aussi en langues bulu et duala.
As-tu déjà été en Afrique ?
Oui j’ai été au Cameroun avec ma maman lorsque j’étais plus jeune, mais il y a eu une cassure puisque ma mère avait décidé de s’installer en France puis aux États-Unis. En 2017, j’ai eu la chance de retourner en Afrique en tant qu’artiste. J’étais aussi au Gabon et au Sénégal.
Cette période de la Covid-19, pour bon nombre d’artistes, a changé la façon de travailler, d’envisager l’avenir, comment la ressens-tu ?
Je comptais terminer mon nouvel album en Afrique, j’avais prévu pas mal de voyages, notamment au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Nigeria. Cet élan a été freiné, il a fallu que je me restructure. C’est une crise qui a mis le monde en pause.
Que t’apporte la musique aujourd’hui ?
La musique m’a permis de me reconnecter avec moi-même, de retrouver mon père, de nourrir ma famille et d’avancer dans la vie.
Tu as produit un single intitulé New Breed, fais-tu partie de cette nouvelle race ?
Je me considère comme un new breeder. New breed, vient d’une expression en swahili, dont je me suis accaparé, qui signifie les loups dorés d’Afrique. Pour la plupart des gens, un loup est associé à l’Europe. Et le fait qu’on trouve aussi des loups en Afrique, signifie, pour ceux qui ont cette double culture comme moi, qu’il y a cet appel du loup qui fait qu’à un moment donné on va vouloir se rapprocher de ses racines. On a besoin de toutes ses forces pour avancer dans ce monde.
Nouvel album : Wolves Of Africa (Grown Kid), 2021